Penser la didactique des langues/cultures, des littératures et de la traduction : regards croisés
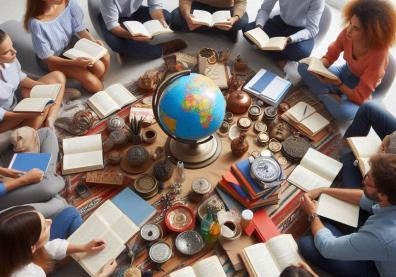
Toute langue est enseignée dans un environnement social qui a ses composantes matérielles et immatérielles : acteurs, finalités, stratégies, valeurs, représentations, imaginaires, priorités, instances de légitimation. Certaines langues sont bien documentées ayant une longue tradition de description et d’enseignement, alors que d’autres peuvent ne pas avoir suscité l’élaboration de grammaires, de dictionnaires, de manuels et de traductions. La didactique des langues, en tant que champ de médiations complexes, est par définition dépendante du degré d’inventivité pédagogique et des pratiques de « didactisation ».
Plus que jamais, l’enseignement-apprentissage des langues nous invite à réfléchir sur la notion d'espace remise en question par les technologies de communication qui envahissent notre univers. La classe n’est plus un compartiment étanche : l'apprenant désireux s’engager dans une variété partenariats, de partager ses productions avec des experts et des natifs distants, voire même avec l'ensemble de la planète, peut se trouver, au même moment, dans la classe et dans une parcelle du monde réel : les deux espaces ayant leurs propres règles sociales leur propre authenticité.
L’apprentissage des langues, et les tentatives d’intervention dans ce processus, afin de l'optimiser, soulèvent bon nombre d’interrogations.
Dans ce cadre, les liens privilégiés qu’entretient la didactique des langues avec les modèles théoriques de la linguistique sont évidents. Lors l’apprentissage des langues, nous affrontons un ensemble de facteurs que la linguistique ne contrôle pas. L’enseignement des langues étrangères s’est trouvé longtemps isolé des réalités sociales. Or, il ne saurait faire l’économie de la prise en compte des contextes géographiques, historiques et idéologiques dans lesquels on utilise (ou non), on étudie (ou non) des langues. Le dosage des observations et des données issues de différentes disciplines contributoires varie d’une méthodologie à l’autre, en fonction de nos présupposés théoriques, objectifs, supports d’apprentissage, programmes et formes de certifications.
Aujourd’hui, nul ne peut échapper à l’hypermobilité. Confronté à des situations plurilingues et pluriculturelles inédites, et articulant les divers éléments constitutifs explicites et implicites de l’identité d’un (ou plusieurs) pays ou communautés, tout enseignement de langue constitue un délicat équilibre entre objectifs linguistiques, culturels, communicationnels et interactionnels sans perdre de vue les volontés politiques institutionnelles.
Approprier une langue, sa culture, sa littérature, apprendre à traduire signifie : développer des compétences et des habiletés, mais aussi aller vers la découverte de l’Autre et vers une meilleure connaissance de soi, apprendre à penser différemment, face à des normes (plus ou moins contraignantes) et des régularités (plus ou moins prévisibles).
Programme et résumés en PDF.