« Connaître et savoir » dans le cours de pratique orale des langues
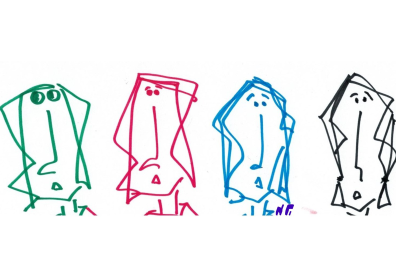
Argumentaire de la manifestation scientifique
Si la production orale en langue est définie comme une compétence en situation sociale qui a une visée informative et communicative, la situation dans un cours de langue correspond, au contraire, à un échange entre enseignants et apprenants (et entre apprenants eux-mêmes) à visée didactique. Il s’agit d’un type d’échange transitoire, où la finalité n’est pas l’échange d’information elle-même mais l’échange « prétexte » à l’apprentissage. L’enseignant est là pour veiller à créer des situations d’échanges, la plupart du temps simulées, mais se rapprochant le plus possible d’une situation authentique.
Dans le cours de pratique orale l’étudiant est invité à mobiliser des ressources linguistiques, discursives, sociolinguistiques et interactionnelles. Il est question d’une compétence de caractère collaboratif et contextuel, dans la mesure où elle fait appel à un ensemble de ressources à mettre en œuvre dans une situation définie et qui ne sont pas transférables à l’identique à tout contexte.
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales le verbe connaître signifierait, entre autres, « savoir quelque chose le plus souvent dans un domaine particulier, moyennant l’étude systématique et/ ou la pratique, l’expérience ». L’accent est mis sur le contenu du savoir ex. : connaître l’alphabet, connaître une langue, une discipline scientifique, connaître un (son) métier, connaître les plantes, etc. Quant au verbe savoir, le sens proposé concernerait le fait de « pouvoir pratiquer une activité suivie, grâce à l’acquisition, par l’étude, par l’application, de connaissances théoriques et pratiques, et à la suite d’une opération intellectuelle ; être capable de ».
Si les connaissances sont organisées autour du vocabulaire, de la grammaire et de l’orthographe, les compétences quant à elles, s’organisent en lire, écrire et s’exprimer à l’oral. Pour
« parler » une langue, il ne s’agit donc pas seulement d’acquérir un vocabulaire et des règles de grammaire, mais davantage de comprendre l’organisation d’une action langagière, ou plus globalement d’une activité pratique, de savoir interpréter les différents marqueurs qui ponctuent l’échange et en modifient parfois le sens, d’identifier les différentes caractéristiques lexicales ou syntaxiques de la langue parlée.
Les enseignants sont très mal armés pour discerner ce qui dans le travail sur le discours appartient aux connaissances et ce qui appartient au savoir (mettre en valeur les connaissances). Ils constatent l’aisance et les difficultés des étudiants face à tels ou tels autres tâches discursives et sont alors amenés à proposer des situations de pratique orale favorisant l’appropriation et l’actualisation du savoir par l’apprentissage de nouvelles connaissances.
Dans un enseignement qui est uniquement fondé sur l’énoncé des savoirs, les étudiants n’auront pas la possibilité de mettre en pratique leurs connaissances dans des situations favorables à l’apprentissage. Au contraire, dans un enseignement mettant l’accent sur l’adaptation aux situations, les étudiants sont amenés à accomplir des tâches, l’une après l’autre, sans qu’elles soient liées à un savoir concret ou lié à un seul type de savoir-faire. Ainsi, se pose la question de la pertinence de l’enseignement organisé en parties distinctes : le savoir dont l’instance de formulation et de validation par défaut est l’enseignant et les connaissances dont l’acteur principal est l’étudiant.
Afin de dépasser cette dichotomie de rôles typée, l’enseignement ne pourrait-il pas être appréhendé comme un va et vient constant entre le savoir et les connaissances actualisés et contextualisés par l’étudiant en tant qu’acteur et validateur dans des situations créées conjointement avec un autre étudiant ou l’enseignant dans un cours de langue ?
Thématiques de travail proposées
- Quels savoirs et quelles connaissances enseigner et privilégier dans des groupes d’étudiants marqués par l’hétérogénéité ?
- Le groupe de travail dans le cours de pratique orale de langue en tant que moteur d’apprentissage des savoirs.
- Comment concilier l’étendue des connaissances personnelles et les limites des compétences langagières communicatives des étudiants ?
- Comment les connaissances partagées en langue peuvent-elles être mises au profit des savoirs individuels à acquérir ?
- Mettre en avant et faire investir les compétences générales des étudiants (savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre) afin de faire développer leurs compétences langagières communicatives.
Cette première journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet « Enseigner les langues : approches novatrices » du CREE.
La journée a lieu à l’Inalco, à Paris en présentiel et avec la possibilité de connexion en ligne.
Programme de la manifestation scientifique
10h-13h05 – Amphi 7 (2e étage)
10h – 10h15 :
- Georges Kostakiotis, Inalco et Snejana Gadjeva, Inalco : « Connaître et savoir » dans le cours de pratique orale des langues
10h15 – 11h35 :
- Madeleine Voga, Université de Montpelier-Paul Valery et Anna Anastassiadis-Syméonidis, Université Aristote de Thessalonique : Transferts inter-langues dans le lexique mental bi-plurilingue. (communication en ligne)
- Magali Cécile Bertrand, Université de Lausanne : Enquêter en contexte homoglotte: deux pratiques d'enseignement du FLE. (communication en ligne)
- Ildikó Lőrinszky, Inalco : Enseigner–apprendre l’expression orale en hongrois : un art du compromis ?
11h45 – 13h05 :
- Xiang Zhang, Inalco : Traduction et enseignement des langues étrangères : quelle place pour la compétence en traduction dans l’acquisition des compétences linguistiques et communicatives ? (communication en ligne)
- Despoina Stefanou, Université de Montpelier Paul Valery : Travailler la production orale dans l’apprentissage d’une langue étrangère : le cas d’hybridation en LANSAD.
- Jing Guo, Inalco : Une nouvelle organisation pour le cours d’expression orale : le cas du chinois à l’Inalco. (communication en ligne)
13h05 – 14h : Pause Déjeuner
14h-18h30 – Amphi 5 (2e étage)
14h – 15h :
- Claire Margolinas, Université Clermont Auvergne et Marceline Laparra, Université de Lorraine : Des questions sur les connaissances et les savoirs de la pratique orale
15h10 – 16h30 :
- Sonia Berbinski, Université de Bucarest : La lecture des signes et des sens – un pont entre l’écrit et l’oral. Pratiques de l’écrit et de l’oral chez les roumanophones : du mot à la parole.
- Sofia Iakovidou, Université Démocrite de Thrace : Le défi de l’auto-narration. (communication en ligne)
- Chan-yueh Liu, Inalco : S’approprier, créer et communiquer : la stratégie d'interprétation performative dans le cours de taïwanais.
16h30-16h50 : Pause-Café
16h50 – 18h10 :
- Fabiana Florescu, Université de Bucarest : Une articulation nécessaire entre savoir et connaître face aux défis de la compréhension et de l’expression orales dans la classe du FLE. (communication en ligne)
- Isabel Zins, Université de Vienne : « Extensive Listening » – une méthode authentique pour développer les compétences linguistiques individuelles.
- Maria Papadopoulou, Université Aristote de Thessalonique et Eleni Gana, Université de Thessalie : Communiquer par et au-delà de la langue. (communication en ligne)
Conclusions / perspectives
18h10 – 18h30 :
- Snejana Gadjeva, Inalco et Georges Kostakiotis, Inalco
Organisation
- Snejana Gadjeva, Inalco/CREE
- Georges Kostakiotis, Inalco/CREE